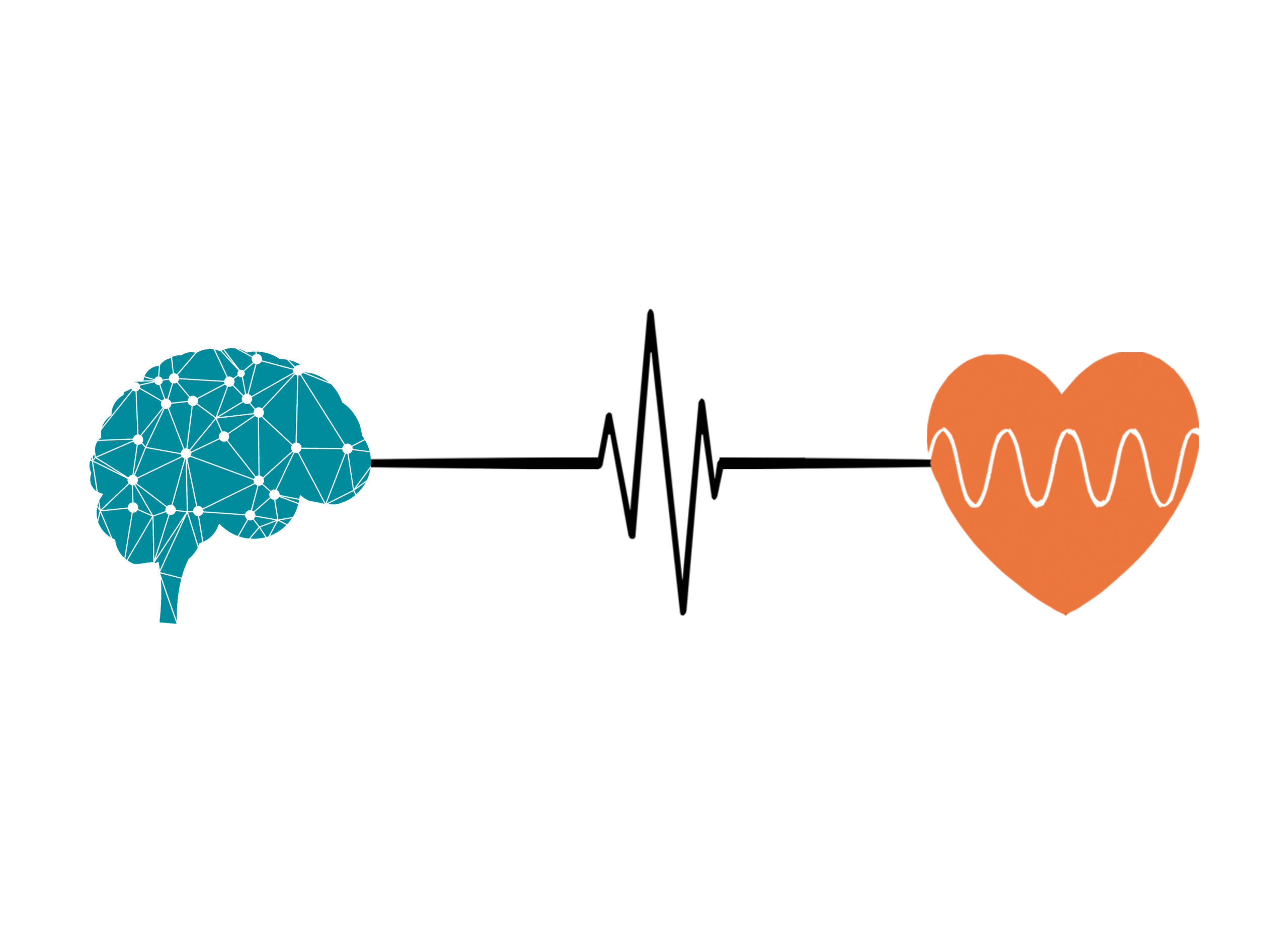Dans le tsunami qu’impose la maladie, l’attention se concentre légitimement sur la personne qui souffre. Pourtant, dans l’ombre de ce combat, se trouvent des figures silencieuses, des piliers qui soutiennent, aiment et endurent : les enfants, les conjoints, la famille, les amis…
Je souhaite aujourd’hui mettre en lumière « les grands oubliés », dont le rôle et la souffrance sont trop souvent relégués au second plan, et explorer avec compassion les conséquences de cette place inconfortable.
Lorsqu’un diagnostic tombe, la vie de toute la famille bascule. Le conjoint devient aidant, confident, gestionnaire de crise. L’enfant, quant à lui, observe, ressent et s’adapte, souvent en silence.
Cette charge, souvent invisible aux yeux du monde extérieur, est immense. Elle est faite de nuits blanches, de soucis financiers, d’une solitude profonde et d’un sentiment de responsabilité écrasant. Le conjoint voit sa relation de couple se transformer, passant d’un partenariat égalitaire à un rôle de soignant, ce qui peut entraîner une perte d’intimité et une grande détresse émotionnelle.
Pour un enfant, voir son parent malade est une épreuve fondatrice qui peut marquer sa construction identitaire de manière indélébile. Confronté de manière précoce à la souffrance, à la peur et à l’incertitude, l’enfant peut développer une maturité précoce, une hyper-responsabilisation qui n’est pas de son âge. Il devient le « parent de son parent », mettant de côté ses propres besoins, ses propres peurs, pour ne pas accabler davantage une famille déjà fragilisée.
Cette inversion des rôles, si elle peut sembler admirable, est une lourde charge qui aura des conséquences sur le long terme. L’enfant peut développer une anxiété chronique, des difficultés à exprimer ses émotions, et une tendance à s’oublier au profit des autres.
Sa construction personnelle se fait alors sur un socle de sacrifices et de non-dits, ce qui peut engendrer, à l’âge adulte, des difficultés à trouver sa place, à nouer des relations saines et à simplement s’autoriser le bonheur.
Le conjoint, de son côté, vit un deuil blanc, celui de la vie d’avant, de la personne que son partenaire était avant la maladie. Il doit faire face à ses propres émotions, la tristesse, la colère, la peur, tout en étant le roc sur lequel toute la famille s’appuie. Il est celui qui rassure, qui organise, qui porte à bout de bras le quotidien. Cette position est épuisante, physiquement et psychologiquement.
Le risque d’isolement est également majeur, car il est souvent difficile de partager ce que l’on vit avec des amis ou de la famille qui ne peuvent pas comprendre pleinement la complexité de la situation.
Briser le silence, trouver sa place En tant que thérapeute, je ne peux que souligner l’importance de reconnaître la souffrance de ces proches. Il est essentiel de leur offrir des espaces de parole, des lieux où ils peuvent déposer leur fardeau sans crainte d’être jugés. Il est crucial qu’ils puissent se reconnecter à leurs propres besoins, à leurs propres désirs, sans culpabilité.
Pour les enfants, il est primordial de leur expliquer la situation avec des mots adaptés à leur âge, de les rassurer sur le fait qu’ils ne sont pas responsables de la maladie de leur parent, et de leur permettre de rester des enfants. De les écouter et de les laisser s’exprimer quelques soit le message.
Pour les conjoints, il est vital de chercher du soutien, que ce soit auprès de professionnels, de groupes de parole ou d’associations d’aidants. La maladie est une épreuve collective, qui ne doit pas faire de victimes collatérales.
En prenant soin des enfants et des conjoints, en leur redonnant une place et une voix, nous aidons non seulement ces individus à se reconstruire, mais nous contribuons également à la résilience de toute la famille face à l’adversité.
Ils me le disent souvent lors de nos séances, ils ne savent plus quelle est leur identité, quelle place prendre dans cette machine infernale.
Si vous avez dans votre entourage et c’est forcément le cas, des accompagnants comme on dit, prenez un moment avec eux, « les grands oubliés de la maladie » pour un sourire vrai, un mot plein de gratitude et une écoute bienveillante.
Merci pour eux !